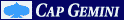
Intranet : la synthèse
techniques, outils, démarches,
applications, conseils pratiques
• Quel est le domaine réellement couvert par l’Intranet. Que peut-on raisonnablement mettre en œuvre aujourd’hui? Quel impact sur la communication, la diffusion d’informations? Quelles conséquences sur l’informatique répartie et le client-serveur?
• L’Intranet impose-t-il une architecture multiniveau? Quelle ouverture du système d’information vers l’extérieur?
• Quels sont les outils de l’Intranet : HTML, DHTML, XML, les scripts, la programmation d’applets ou d’ActiveX? L’avenir de Java est-il sur le poste client ou sur le serveur?
• Quelles alternatives techniques? Quelle offre commerciale? Quels critères de choix?
• L’Intranet permet-il réellement de résoudre le problème de l’hétérogénéité et de l’administration des postes clients et de les "alléger"?
• Quels risques pour la sécurité? Quelles parades efficaces?
• Quelle remise en cause de l’existant? Comment intégrer l’Intranet, quelles démarches pratiques? Quelles contraintes de mise en œuvre?
• Quel budget, comment chiffrer le coût complet d’une solution Intranet?
En trois journées denses, ce séminaire apporte une synthèse complète, structurée et didactique des connaissances aujourd’hui indispensables en matière d’Intranet. Il analyse et évalue l’offre du marché. Il examine les démarches pratiques de mise en œuvre, en insistant sur les difficultés et sur la façon de les contourner.
1. De l’Internet à l’Intranet et à l’Extranet
•
Intranet, Extranet et Internet : quelques définitions et rappels. Vers une généralisation de services centrés sur le "triptyque organisationnel" (données, messages et documents). Vers une banalisation du poste de travail et l’ouverture du système d’information de l’entreprise vers l’extérieur. Quel est le prix à payer? Une régression en terme d’interfaces? Une recentralisation des programmes et des données?•
Architecture de référence de l’Intranet : Internet, les services, standards et organisations qui le supportent (ISOC, W3C, IETF, etc.). Le processus d’élaboration des standards ouverts. Physionomie actuelle et perspectives.•
Les points forts et les points faibles du Net. Quelles leçons en tirer pour l’Intranet?2. Technologies et infrastructures de l’Intranet
•
Panorama des standards à la base des services offerts.- Protocoles de réseau : transport (TCP/IP), adressage, URL, routage, nommage (DNS).
- Services de communication : connexion à distance (Telnet), messagerie (SMTP/MIME, POP3, IMAP4), forums et groupes (NNTP), agenda (ICAP), discussions interactives (IRC).
- Services de diffusion d’informations : partage de fichiers (NFS), transfert de fichiers (FTP). Le Web et les serveurs hypermédias (HTTP, HTML).
- Services de recherche d’informations : index, annuaires et moteurs de recherche (Yahoo, AltaVista, DejaNews, etc.), agents intelligents.
- Services de sécurisation et de confidentialité : algorithmes (DES, RSA, etc.), protocoles (SSL, S-MIME, PGP, etc.), certificats X-509 et offre commerciale (Verisign, Security Dynamics, etc.).
•
Les technologies émergentes : VRML, téléphonie, son et vidéo, visioconférence, Vidéomail, etc.•
Le concept de push d’informations en continu (Webcast) : Pointcast, Active Desktop, Marimba. Le Multicast.•
La programmation côté browser (scripts, plug-in, applets et ActiveX) et côté serveur (CGI, servlets).•
Les outils de l’internaute sur son poste de travail : "browser" Web (Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, etc.), client de messagerie, etc.•
Vers le poste de travail universel? Vers une sophistication des browsers (Netscape Communicator) ou une intégration des browsers au sein des systèmes d’exploitationOS (Windows 98 et IE4)? Quelle place pour les Network Computers, les "thin" clients et les Terminaux Windows?3. Intranet et la diffusion-publication d’informations
•
Les différentes versions de HTML : frame, image, l’intégration des tableaux, des vecteurs et du 3D. L’intégration de programmes. Les feuilles de style. La version HTML 4.0. Quelle prise en charge par les principaux browsers?•
L’évolution actuelle : Dynamic HTML, les feuilles de style en cascade (CSS), le DOM (Document Object Model). La rupture de XML : l’introduction des DTD et les déclinaisons actuelles (CDF, OSD, DRP, ICE, RDF, XSL, SMIL, etc.). Quelles perspectives? Quel sera l’apport d’Office 2000?•
La création de pages HTML par les suites bureautiques (Office 97, Smartsuite 97, etc.), et les produits auteurs complets (Hot Metal Pro, FrontPage, PageMill, etc.). Mise en place de Web statique et dynamique. L’intégration de graphiques, images, animations, et l’accès aux documents dans leur format natif.•
La diffusion de fichiers par FTP. Intérêt de la constitution de serveurs internes FTP Anonymous. Le partage de fichiers s apports de CIFS et NFS.•
La gestion documentaire sur le Web : outils de publication et utilisation de moteurs d’indexation et de recherche intégrés (Topic/Verity, Fulcrum, Index Server, Catalog Server, etc.). Intérêt d’un site de recherche multi-serveurs au sein d’un Intranet? Les outils d’extraction et de réplication de sites. L’utilisation de proxy.•
Panorama de l’offre de serveurs Web : Internet Information Server, Apache, Netscape Enterprise, Domino, Purveyor, etc. Sur NT ou sur Unix?4. Intranet, messagerie, groupware et workflow
•
L’ouverture des messageries propriétaires vers le Net. Intégration des mobiles et d’interlocuteurs extérieurs. Passerelle SMTP ou migration : les données du choix. La problématique du plan de nommage et de l’annuaire. L’accès aux annuaires via LDAP. Vers une régression par rapport aux messageries en place au plan du graphisme, des fonctionnalités? L’apport de MIME et de IMAP4. Les perspectives en matière de gestion d’agenda partagé (ICAP). S/MIME et la sécurité.•
Mise en place de forums et de groupes de travail. Utilisation de serveurs de news NNTP et de fonctions intégrées aux messageries. Quels domaines applicatifs? Différentes options et solutions offertes.•
Les perspectives du workflow via le Net. Circulation de formulaires, suivi de processus et coordination de tâches. Prise en compte par les progiciels du marché : Jetform, W4, Teamware, etc.•
Les autres fonctions. Applications collaboratives synchrones : travail sur document, communication (NetMeeting), vidéoconférence (NetShow), Vidéomail, etc.•
L’évolution des produits du marché vers l’intégration en standard de l’Internet : Notes et Domino, Exchange, Netscape SuiteSpot, etc. Quels recours à des services externalisés (HotMail, HotOffice, etc.)?5. Intranet et client-serveur
•
Les types de client-serveur supportés par l’Intranet. Est-on limité au client-serveur de présentation? L’Intranet impose-t-il une architecture à trois niveaux ou plus? Les applicatifs doivent-ils être implantés sur les clients ou le serveur? Que sont les serveurs de scripts et les serveurs d’application?•
La programmation du client Intranet. Les différentes voies : script, applet, plug-in. L’utilisation de langages de script sur le client : Java Script, JScript et Visual BasicVB Script. Sont-ils compatibles? Quel est leur domaine d’utilisation? Le recours à Java. Les API et outils des différentes versions : AWT, JNDI, JDBC, JAR, etc. Points forts et points faibles de Java. Interprétation, compilation JIT et code natif JNI. Problèmes liés au téléchargement d’applets et à l’utilisation de machines virtuelles. Jusqu’où peut-on allerQuel sera l’apport de HotJava et des JVM Plug-in? Faut-il avoir recours aux API de Windows (J/Direct)? Les outils graphiques de développement en Java : Visual J++ (Microsoft), Visual Café (Symantec), Java Workshop (Sun), JBuilder (Borland), etc. L’affrontement sur les modèles de composants (Beans versus ActiveX) et les protocoles inter-objets (DCOM versus RMI et IIOP/Corba). De l’interface graphique à fenêtres de Windows à la navigation hypertextuelle du browser : quels sont les avantages et les problèmes posés par le changement de métaphore?•
Les Intranets d’accès aux données et les serveurs de scripts. Les API d’interface : CGI, ISAPI, NSAPI. Les langages de programmation : Perl, Java Script, VBScript, etc. L’offre de serveurs de scripts : Site Server-ASP (Active Server Pages) de Microsoft, ColdFusion d’Allaire, Intrabuilder d’Inprise, etc. Les interfaces et les middlewares d’accès aux bases de données : JDBC, ODBC, Active Data Objects de Microsoft, LiveWire de Netscape, NetData d’IBM, etc. Les nouvelles versions de SGBDR avec interface Web intégrée. Les AGL spécifiques de développement : Visual Interdev (Microsoft), Drumbeat, WebDB, etc.•
Comment résoudre les écueils? Absence de persistance, non-identification des clients et gestion de transactions? Comment identifier l’utilisateur et valider un logiciel téléchargé :Le recours aux cookies, marqueurs, URL longs, etc..? Comment s’affranchir des incompatibilités entre les différents browsers et leurs différentes versions? Les outils de tests disponibles.•
Les Intranets applicatifs et les serveurs d’application. Caractéristiques. Importance des OTM (moniteurs transactionnels objets) basés sur des protocoles synchrones ou orientés messages : MTS de Microsoft, Component Broker d’IBM, Jaguar CTS de Sybase, M3 de BEA, etc. Place des servlets et des EJB (Enterprise Java Beans) de Sun. Le projet "San Francisco" d’IBM. Les offres de serveurs d’applications complets : WebSphere d’IBM, NetDynamics de Sun, Kiva de NetscapeOracle Application Server, HahtSite, Forté, etc. Les AGL graphiques orientés composants : évolution des outils existants (Visual StudioBasic, Powerbuilder, etc.) et nouveaux produits (Visual Café, Java Studio, SilverStream, Sapphire, etc.).•
L’impact sur les SGBD : stockage "Universel"multimédia (Oracle 8i) et serveurs dédiés (Raw Iron).•
L’Intranet comme passerelle d’accès aux applications et aux serveurs de données. L’émulation 3270 ou le Query dans un simple browser : eNetwork d’IBM, Extra!Objects d’Attachmate, Web Intelligence de Business Objects, etc.6. Impact d’Intranet sur le système d’information
•
Quelle démarche pour évoluer vers l’Intranet? Un Extranet peut-il constituer la base d’un RIP (Réseau Internet Privé) en se substituant au WAN propriétaire? Quel est le profil du poste de travail client Intranet à privilégier? Peut-il être "léger"?•
Le passage à IP est-il un préalable? Un protocole classique (IPX, NetBEUI) peut-il être utilisé? Comment gérer l’adressage IP? Les trois classes d’adresses et les conflits d’adressage. Le passage à IPv6 impliquera-t-il une migration lourde? Avantages et inconvénients du protocole DHCP et de l’affectation dynamique d’adresses. Quelle est la charge réseau à envisager pour le support de l’Intranet?•
Quelle stratégie en matière d’annuaire unique (Méta-annuaire) prenant en charge le réseau, la sécurité, l’administration des postes de travail? Les offres nouvelles (Meta Directory d’Isocor, Directory Server de Sun/Netscape, ADS Active Directory de Microsoft, etc.). Comment assurer la coexistence d’annuaires de type NDS avecavec les annuaires existants (NDS, messagerie,..), les domaines DNS?•
L’évolution de l’offre. Que penser des "suites serveur" complètes : BackOffice de Microsoft, Netscape SuiteSpot, IBM/Lotus, Oracle? Quel avenir pour l’offre Netscape?•
Comment se raccorder au Net? Quel recours à l’externalisation? Les offreurs de services et de connectivité. Spécificité et typologie des opérateurs et providers, ainsi que des solutions proposées. Quels apports des services d’Intranet "externalisés" (Global Intranet, HotOffice, etc.)?•
Comment assurer une sécurité satisfaisante? Protection d’accès, authentification et cryptage. Mode de fonctionnement et efficacité d’un firewall (fil de l’eau, séparation de réseau). Panorama de l’offre : CheckPoint, Borderware, Raptor, etc. Zone démilitarisée DMZ et utilisation de routeur, firewall et proxy. La lutte contre les virus (Webscan, InocuLAN, etc.).•
Problématique posée par le Network Computing : utilisation de surcouches multi-utilisateurs des OS (Winframe, Windows NT Terminal serveur). L’offre de NC : Netstation d’IBM et Java Station de Sun, etc. Place des protocoles de déport d’interface (ICA, RDP) et du terminal Windows. Impact de la recentralisation sur le nombre de serveurs, leur disponibilité et la charge réseau.7. Aspects économiques et organisationnels : comment passer à l’Intranet?
•
Intranet au sein de la DSI. Comment prendre en charge et maîtriser la technologie Intranet au sein de la DSI? Quels sont les domaines où l’Intranet est bien adapté aujourd’hui?•
Les spécificités de la gestion du projet Intranet : l’inventaire informationnel. La cartographie des gisements. Comment déterminer les applicatifs adaptés à l’Intranet? Quels profils au sein des équipes? Quelle méthodologie utiliser?•
Les problèmes spécifiques d’administration et de maintenance liés à l’Intranet. Comment suivre le trafic et les "hits" sur les Webs? Les offres de Webtrends, NetAnalysis, I/Pro, WebMeter, etc. Comment maîtriser l’inflation informationnelle? Le rôle du Webmaster. L’administration via le Web (WBEM).•
La réalité des coûts et de la maturité de l’offre. L’Intranet est-il vraiment le système d’information d’entreprise du futur?Le texte de ce programme a été arrêté le 28 janvier 1999. Bien évidemment, cependant, la documentation remise aux participants lors du séminaire et, a fortiori, l’analyse et les commentaires, prendront en compte les faits nouveaux intervenus avant la date du séminaire, et notamment les nouvelles initiatives majeures des principaux acteurs du marché.
DURÉE : 3 journées
DATES : 28-30 avril 99
7-9 juin 99
25-27 août 99
18-20 octobre 99
1-3 décembre 99
PRIX : 11 950 F ht
Renseignements : Véronique Groud,
tél. : 01 44 74 24 10, fax : 01 43 47 24 24
e-mail : vgroud@capgemini.fr